 |
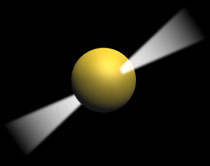 |
|
Doc. 51. Deux modèles
de pulsars. A gauche, le champ magnétique, à droite, le
faisceau d’ondes radio
|
||
 |
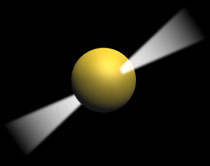 |
|
Doc. 51. Deux modèles
de pulsars. A gauche, le champ magnétique, à droite, le
faisceau d’ondes radio
|
||
Le premier pulsar a été découvert par hasard par Jocelyn Bell et Anthony Hewish en 1967 en étudiant des galaxies lointaines. Jocelyn Bell a remarqué des pulsations de radiation quand leur télescope pointait une position particulière dans le ciel et pour un court moment, des scientifiques ont cru qu’elles pouvaient venir d’une civilisation extraterrestre. En fait la source de ces pulsations a été appelée au départ LGM1, Little Green Man 1. Une fois établi que les signaux n’étaient pas de cette origine (et aussi non générés sur Terre), l’objet non identifié dont ils provenaient a été appelé « un pulsar » parce que l’émission était intermittente. On appelle maintenant le pulsar découvert par Bell et Hewish PSR B1919+21 : PSR représente la Source Pulsatile Radio et B1919+21 indique la position du pulsar dans le ciel. Bien que les pulsars aient été d’abord découverts comme les sources radio ils sont maintenant observés en utilisant l’optique, les Rayons X et les télescopes à rayons gamma.
Les astronomes ont maintenant découvert plus de 1500 pulsars et s’attendent à en découvrir des milliers en plus dans les prochaines années. Plus des deux tiers des pulsars actuellement connus ont été découverts en utilisant le radiotélescope de Parkes. L’énorme radiotélescope d’Arecibo à Porto Rico, les télescopes de Green Bank en Amérique, le télescope Molonglo en Australie et le Jodrell Bank Telescope en Angleterre ont aussi contribué significativement dans la découvert de pulsars.
Un astronome qui recherche un pulsar positionnera le radiotélescope sur une région de ciel pour une durée comprise entre quelques minutes et douze heures (de plus longues observations permettent à l’astronome de découvrir des pulsars plus faibles, mais demande une veille prolongée). La réception du télescope est enregistrée en continu sur un ordinateur qui a besoin d’un disque dur de grande capacité (une recherche récente à Parkes a conservé l’équivalent de 8000 CD de données). Les données sont ensuite analysées afin d’identifier des signaux périodiques du même type que ceux trouvés par Jocelyn Bell qui confirmeraient la présence d’un pulsar. Si le télescope est branché à un haut-parleur convenable (au lieu d’enregistrer les données sur un système informatique), on pourrait entendre le signal radio émis par un pulsar suffisamment puissant.
Cliquez
pour entendre le son émis par le pulsar du Crabe. |
Centre de la Nébuleuse du Crabe. Cliquez pour agrandir |
|
PSR B0531+21,
Le Pulsar du Crabe.
Le pulsar de la Nébuleuse du Crabe est un très jeune pulsar. La Nébuleuse du Crabe représente les restesd'une supernovae dont l'explosion a été observée en plein jour par les Chinois et les Européens en 1054. Le pulsar a une période de rotation de 30 fois par seconde. |
||
Lorsque l’on entend le signal émis par un pulsar, on comprend facilement
pourquoi il a été au départ pris pour des extraterrestres
essayant de communiquer avec nous !
La période du pulsar est l’intervalle de temps séparant deux pulsations consécutives. Les périodes d’une seconde sont typiques bien que l’on ait trouvé des pulsars avec des périodes de quelques millisecondes jusqu’à huit secondes. Le temps entre les pulsations est incroyablement régulier et peut être mesuré avec une très grande précision. Par exemple, le pulsar appelé PSR J1603-7202 a une période de 0,0148419520154668 secondes. Pourtant les périodes de tous les pulsars radio augmentent extrêmement lentement. La période de PSR J1603-7202 augmente de juste 0,0000005 secondes chaque million d’années ! Il existe deux types principaux de pulsar. On appelle ceux avec les périodes de quelques millisecondes et dont les périodes se changent très lentement les millisecond pulsars. Les autres sont simplement appelés « pulsars ordinaires ».
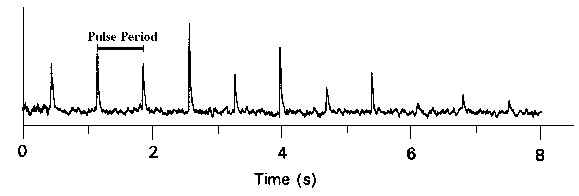 |
Doc. 52. Cet enregistrement révèle
les pulsations du pulsar PSR B0329+54. Les pulsations peuvent sembler
radicalement différentes les unes des autres tant dans la forme
que dans l’amplitude comme on le voit sur le tracé. |
Avant d’expliquer ce que sont réellement les pulsars, voyons ce que les observations de pulsars nous apprennent.
Chaque pulsation est composée d’ondes radioélectriques
de différentes fréquences comme la lumière blanche est
composée de toutes les couleurs du spectre. On a remarqué que
les plus hautes fréquences d’une pulsation arrivent à un
télescope légèrement avant les fréquences plus basses.
La raison de ce décalage est due au fait que la pulsation a voyagé
à travers le milieu interstellaire et que les différentes fréquences
composant la pulsation voyagent à des vitesses différentes à
travers ce milieu. Ceci est appelé la dispersion des pulsations et est
due aux électrons libres présent dans le milieu interstellaire.
Les pulsars les plus lointains sont plus dispersés que les plus proches
si bien que les retards de temps entre les différentes fréquences
peuvent être utilisés pour estimer la distance approximative du
pulsar.
A part quelques pulsars présents dans des galaxies voisines, les Nuages
de Magellan, la plupart des pulsars trouvés sont largement à l’extérieur
de notre système solaire, mais dans notre Galaxie. On trouve les jeunes
pulsars (nous les appelons jeunes, mais ces pulsars ont malgré tout plusieurs
milliers d’années) dans le plan de notre Galaxie la Voie lactée.
Les plus jeunes sont trouvés dans les restants de supernova ce qui suggère
qu’ils sont probablement « nés » durant l’explosion
d’une étoile massive.
On a trouvé que ces jeunes pulsars voyagent rapidement à travers l’espace. Certains pulsars se déplacent même 4000 fois plus rapidement qu’un avion gros porteur et prendraient seulement 16 secondes pour franchir la distance Sydney - Londres ! Lors de leur vieillissement, ils sortent du plan de la Galaxie. Les pulsars les plus rapides ne reviendront jamais : ils s’échapperont de la Galaxie et voyageront dans l’espace entre les galaxies devenant ainsi non détectable. D’autres ralentiront et resteront à proximité du plan galactique où ils continueront à osciller de haut en bas pour le reste de leur vie.
La plupart des étoiles dans notre Galaxie sont dans
une orbite avec une autre étoile (notre Soleil est inhabituel puisqu’il
n’a pas de compagnon stellaire). De même beaucoup de pulsars (en
particulier les millisecond pulsars) sont trouvés dans les systèmes
binaires. Les compagnons des pulsars sont des étoiles normales, des planètes,
des naines blanches, des étoiles à neutrons et même, grâce
à une récente découverte, un autre pulsar. Le fait d’étudier
le mouvement du pulsar dans un système binaire permet aux astronomes
de comprendre beaucoup de choses sur le pulsar, son compagnon et leurs orbites.
Dans quelques systèmes, la masse du pulsar peut être déterminée
: on trouve qu’elle est à peu près une fois et demi plus
massives que notre Soleil. Nous savons aussi que les pulsars sont très
petits et donc qu’ils doivent être très denses. En fait,
une cuillerée de matériel provenant d’un pulsar pèserait
un milliard de tonnes si nous l’apportions à la surface de la Terre.
En résumé :
Les pulsars :
En 1934 Walter Baade et Fritz Zwicky ont prédit l’existence d’étoiles à neutrons : les étoiles qui se sont effondrées sous leur propre gravité pendant une explosion de supernova. Les étoiles comme notre Soleil ne formeront pas d’étoiles à neutrons. Après avoir épuisé tout leur combustible, de telles petites étoiles deviennent des naines blanches. Seulement les étoiles très massives (au moins plusieurs fois plus massives que notre Soleil) subiront une explosion de supernova et deviendront des étoiles à neutrons. Les étoiles encore plus massives s’effondreront pour former des trous noirs.
On a cru que les étoiles à neutrons ne seraient
jamais détectables par des télescopes sur Terre. On les a prédits
pour être très denses, tourner très vite, avoir un rayon
très petit de seulement de 10 km et posséder un grand champ magnétique.
Pourtant, nous savons maintenant que des particules chargées se déplaçant
le long d’un champ magnétique peuvent causer l’émission
de faisceaux de radiation au niveau des pôles magnétiques. Comme
l’étoile à neutrons tourne, le faisceau balaierait l’espace
autour de lui. Quand ce faisceau est dans la direction de la Terre, une pulsation
peut être détectée grâce à un radiotélescope.
Ce modèle du « phare » pourrait-il expliquer ce qu’est
un pulsar ?
 |
|
| Cliquez
pour agrandir |
Si nous comparons les observations des pulsars mentionnés
plus haut avec la description d’étoiles à neutrons dans
le deuxième nous trouvons beaucoup de similarités. Les pulsations
qui se produisent à intervalles réguliers correspondent à
un faisceau émis d’une étoile de neutron tournante. Le temps
entre les pulsations, la période, est le temps que prend l’étoile
à neutrons pour effectuer une rotation. L’augmentation de la période
du pulsar est due au léger ralentissement occasionné par la perte
d’énergie au cours du temps. Les plus jeunes pulsars sont trouvés
dans les restants des supernova ce qui est exactement l’endroit où
nous nous attendrions à ce que les étoiles à neutrons naissent.
Ainsi, l’explication la plus probable est qu’un pulsar est une étoile
à neutrons qui tourne rapidement et émet des ondes radioélectriques
le long de son axe magnétique. Pourtant, toutes les étoiles à
neutrons ne sont pas nécessairement détectables comme les pulsars.
Les faisceaux de quelques étoiles à neutrons peuvent ne jamais
passer par la Terre et ne seront donc pas détectables. Il se peut aussi
que d’autres étoiles à neutrons aient été
des pulsars dans le passé, mais le processus qui provocant le faisceau
de radiation (qui n’est d’ailleurs pas complètement compris)
peut s’être éteint ou est simplement trop faible pour être
découvert.
Les deux types de pulsar (les pulsars ordinaires et les millisecond pulsars) peuvent être expliqués en supposant que tous les millisecond pulsars étaient à l’origine en orbite avec une autre étoile. Après la formation du pulsar, de la matière a été tirée de l’étoile de compagnon vers le pulsar. Durant ce processus, le pulsar s’est mis à tourner de plus en plus vite jusqu’à ce qu’il devienne un millisecond pulsar. Ensuite, l’étoile compagne meurt et devient une naine blanche, une étoile à neutrons ou trou noir selon sa taille originelle. Si l’étoile compagne reste dans l’orbite avec le pulsar, un système de pulsar de milliseconde binaire pourrait être formé.
Personne n’est tout à fait sûr de ce qui
arrive exactement à un pulsar quand il vieillit et ralentit. Il est probable
qu’après quelques millions d’années le faisceau de
radiation s’éteint : soit parce que le champ magnétique
du pulsar s’estompe soit parce que le faisceau devient juste de plus en
plus faible jusqu’à devenir non détectable. Ces problèmes
devraient être résolus en étudiant certains nouveaux pulsars
récemment découverts.